
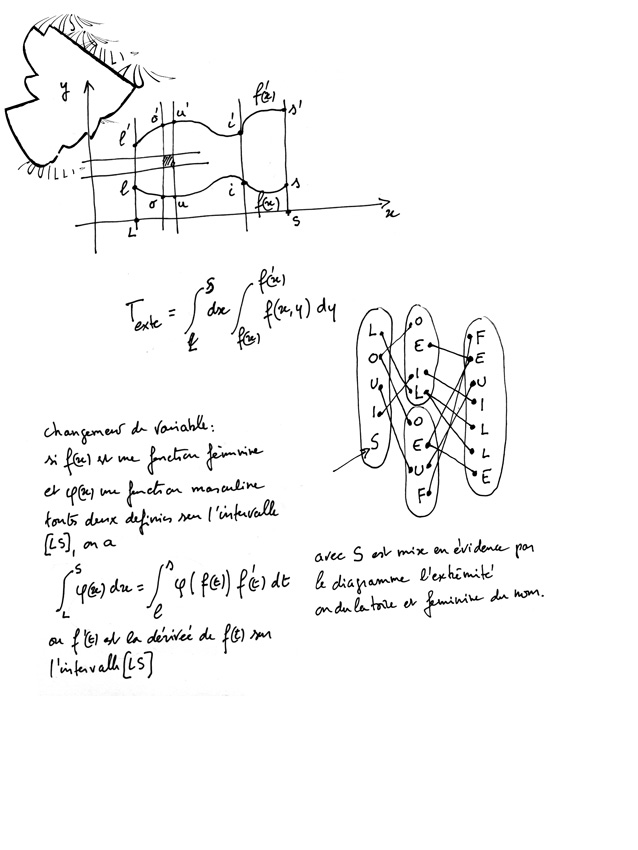
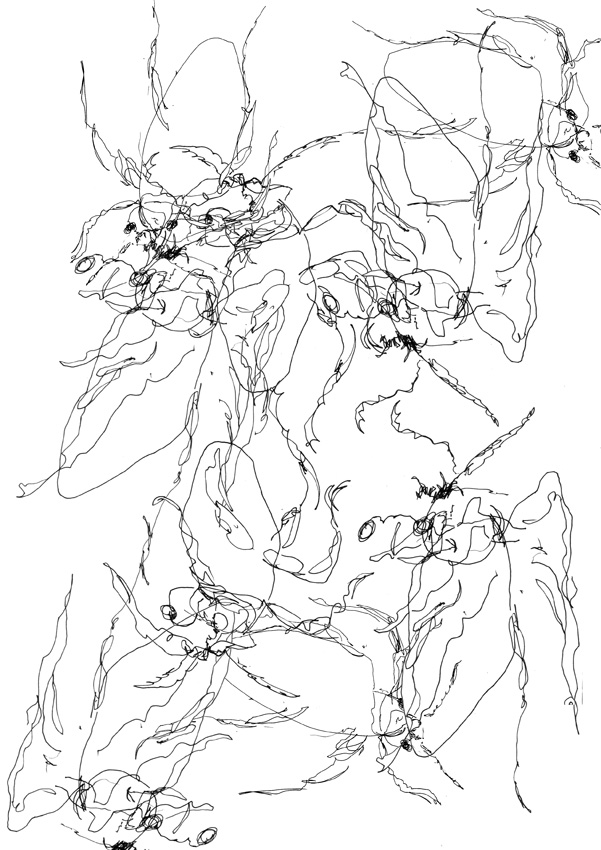
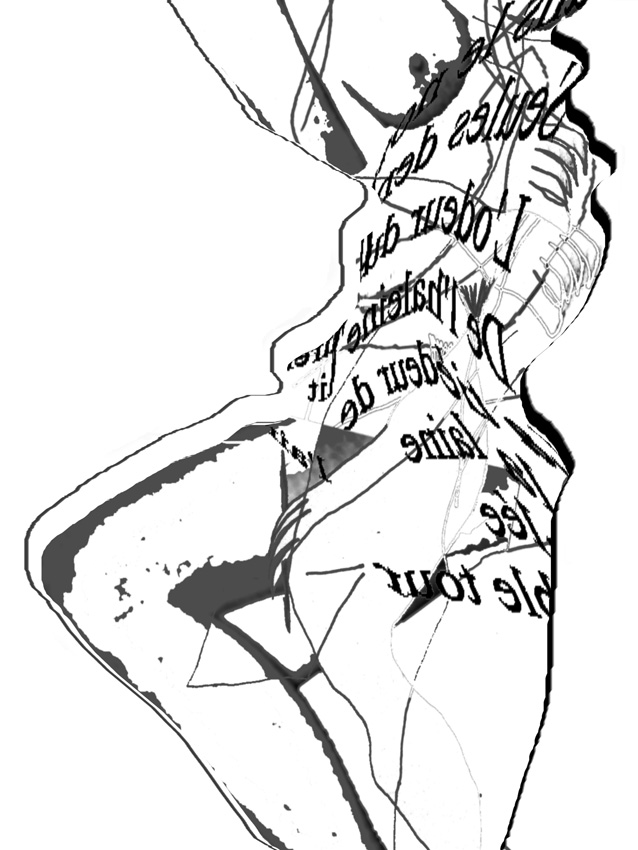
Matelamatique des genres. Trace(s), Passage d'encres, Romainville.
"Avons-nous les organes qu'il nous faudrait ? C’est la question
de corps et de la littérature. Celle aussi de leurs organes et
de leurs pressions anatomiques et mentales. De Vaulchier les poursuit
en divers états "du presque lyrique au presque scientifique".
L’issue est mince puisque créer c’est se mettre dans
le sens de l’être. A savoir "l'Etrangère",
peut-être la Kiki de Malakoff auquel ce superbe livre est dédié…
sans pour autant épouser ses penchants et ses pas. Mais l'auteur
y parvient. D’où la densité progressive de cet ouvrage
expérimental dans son approche langagière et stratégique.
Tout y est comme en écarts. Mais en écarts bouillonnants.
Tout y est aussi drôle que glissant, sérieux et impertinent.
Un tel texte rappelle celui d'une fusée de la littérature
: Joëlle de la Casinière est son (pratiquement) seul livre
écrit peu de temps avant sa mort "Le Pays où tout est
permis" (Editions de Minuit). Mais, en surchauffe et avachi (forcément
avachi pour tes raisons matelassière) le livre de de Vaulchier
regorge de plus d'énergie et d'intelligence. Il tente une traversée
vers un invincible repos (même si ce n'est pas le mot qui convient…).
De Vaulchier sait combien le corps est un gouffre. Inertie, énergie
s'y chevauchent. Même la station active fait travailler l’invincible
et le repos inné. Il ne faut donc pas expliquer l’être
mais le sortir de ses ressorts (à matelas). Ne pas penser à
sa propre nature mais envisager l’existence autre.
L'auteur de "Matelamatique" ne cesse d’aller comme disait
Artaud « au point où on ne peut plus gouler ». Il apprend
à se battre avec les images et leur inconscient. Bond en dedans
pour avancer. Arrêt sur image. Restent les stigmates en espérant
que les "carreaux piqués" de l'objet s'ouvriront un jour
en boutons de roses, qu'ils s'épanouiront comme les pétales
frêles des coquelicots.Mais comment nous libérer de notre
prison ? Là est toute la question. C'est pour cela que l'auteur
présente propositions, calculs, dispositifs, objets, corps et actions.
Il nous apprend de facto qu'il ne faut pas attendre que l'on nous aime
avec toute notre crasse, nos saletés et notre médiocrité.
Loin de tout psychologisme il revient à l'essentiel. Quel est le
corps qui fait ? Que fait le corps non seulement quand il devient le prolongement
d’autres jambes que les siennes ? L'auteur "analyse" les
faits et gestes de peau et de chair. Il examine comment transformer la
tiédeur en surchauffe.
Il fait aussi ressentir la sensation d’être pendu dans le
vide, de regarder hors de soi. En ses images stratégiques des parties
de corps ont été détachées. Elles deviennent
indépendantes et comme témoins des restes. Créer
pour de Vaulchier revient (entre autres) à désarticuler
avec un regard d'en dedans. Double regard même pour ramasser les
insectes de la pensée qui volent de tous côtés avec
des étirements, des prolongations parfois des sutures. Mais pour
lui il faut préférer les beaux déchets aux chutes
Car c'est toujours par en dessous qu’on touche le mieux.
Le livre distribue une suite de moments rares, rentrés d’épines
enfoncées dans les idées. Il ne conserve que ce qui s’étire,
transperce, ramasse, pénètre, glisse. Devant tout ce travail
de « cruauté » on reste pourtant tenté de parler
de bonheur. N'est-ce pas la vie que l'on cherche que l'auteur veut sauver
? Pas n'importe comment. Son texte invente de nouvelles pistes langagières
et de nouveaux cadres. Il mélange les genres pour mélanger
les corps.Tout ne s'emboîte pas "en corps" mais c'est
bien là tout l'intérêt d'un livre qui a mal à
ses formes pour nous faire jouir un peu plus. Et même si martèle
dans notre crâne un « ça n’a pas d’issue
», l'auteur s'y enfonce, soulève ses écailles. Il
est l'éveillée qui s'inscrit au registre de l’avenir.
Il est un monde de carcasses aux échines ramassées sur le
matelas des songes. A sa manière il épelle l’exaltation
pour qu’elle soit. Le corps s’ouvre, se laisse écarter.
On regarde d'u oeil reculé, physiologique, cosmique par le dehors
ses impulsions du dedans." Jean-Pierre Gavart-Peret 2009